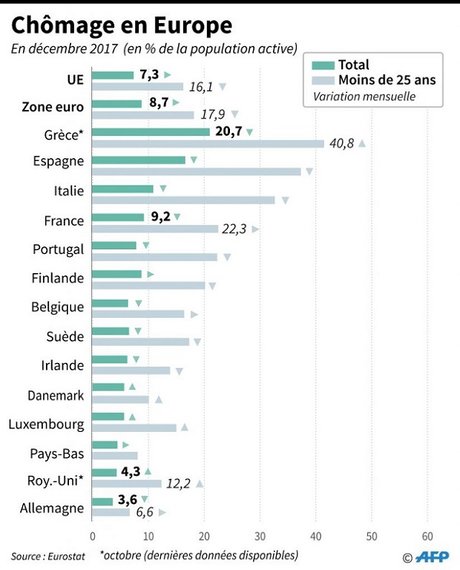Brexit : Londres rejette fermement la proposition de Bruxelles sur l’accord de divorce
La question de la frontière entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord demeure le point de blocage.
LE MONDE | • Mis à jour le |Par Eric Albert (Londres, correspondance)

Il aura fallu à peine plus d’une demi-heure mercredi 28 février au gouvernement britannique pour rejeter avec véhémence la proposition d’accord de divorce préparée par la Commission européenne sur le Brexit. « Aucun premier ministre britannique ne pourrait jamais l’accepter, a lancé Theresa May devant la Chambre des communes, lors de la séance hebdomadaire des questions à la première ministre. Je dirai de façon très claire au président [de la Commission européenne, Jean-Claude] Juncker et à d’autres que nous ne l’accepterons pas. »
Le contentieux concerne la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Bruxelles propose de créer une « aire réglementaire commune » entre les deux Irlandes, afin d’éviter le retour d’une frontière physique entre elles. Selon Mme May, « l’intégrité constitutionnelle » du Royaume-Uni serait mise en danger par la proposition européenne. Le langage est particulièrement peu diplomatique et rejoint un concert de protestations au Royaume-Uni. « Grotesque, inacceptable », estime Christopher Montgomery, un ténor du Parti unioniste démocrate (DUP, parti unioniste nord-irlandais). « Ça ne peut pas être accepté, ni par nous, ni par le gouvernement britannique », renchérit Nigel Dodds, un député DUP. « Cela revient à une annexion de l’Irlande du Nord par l’Union européenne », estime David Jones, un député conservateur, ancien secrétaire d’Etat au Brexit.
Européens et Britanniques sont d’accord sur le principe : il ne faut pas réintroduire de frontière visible, qui risquerait de rouvrir les plaies des années de violence entre unionistes et républicains (3 500 morts entre 1969 et 1998). La question est de savoir comment y parvenir. Pour l’UE, la solution la plus simple est que le Royaume-Uni reste dans le marché unique et l’union douanière, les deux dispositifs qui permettent la circulation des marchandises et des personnes sans vérification. Mais Mme May l’a exclu.
En décembre 2017, Londres et Bruxelles avaient trouvé un compromis particulièrement ambigu, en trois étapes. D’abord, le Royaume-Uni s’engageait « à proposer une solution spécifique » sur l’Irlande du Nord. Mais, en son absence, il acceptait de « maintenir l’alignement complet » avec le marché unique et l’union douanière. Dans le même temps, pour rassurer les unionistes, le texte assurait aussi qu’il n’y aurait pas non plus de frontière « est-ouest » passant dans la mer d’Irlande, qui séparerait le Royaume-Uni en deux : en clair, les contrôles douaniers ne se feraient pas au niveau des ports et des aéroports de l’île d’Irlande. Reste que ces trois objectifs contradictoires ne disaient toujours pas comment y parvenir.
« L’Irlande du Nord est utilisée politiquement »
Depuis, la Commission européenne s’est attelée à traduire cet accord politique en texte juridique. Le résultat, publié ce mercredi, n’a pas du tout plu aux Britanniques. Il souligne que Londres peut effectivement proposer une solution spécifique au problème irlandais s’il en trouve une. Mais, en son absence, le texte détaille dans un protocole séparé ce que signifierait ce fameux « alignement complet » avec le marché unique et l’union douanière.
Il va très loin, précisant que la Cour de justice de l’Union européenne devrait rester compétente sur l’Irlande du Nord, ce qui va à l’encontre des lignes rouges de Mme May. « Le territoire de l’Irlande du Nord sera considéré comme faisant partie de l’union douanière de l’UE », précise-t-il. Les différents régulateurs britanniques (environnement, santé…) n’auraient pas l’autorité de vérifier les biens arrivant en Irlande du Nord, cette tâche revenant aux organismes européens.
« La proposition de texte, si elle était appliquée, mettrait à mal le marché unique britannique, et mettrait en danger l’intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni en créant une frontière douanière et régulatrice dans la mer d’Irlande. »
Boris Johnson, le ministre des affaires étrangères, estime qu’il s’agit d’une manœuvre politique de Bruxelles :
« L’Irlande du Nord est utilisée politiquement pour garder le Royaume-Uni dans l’union douanière et le marché unique, pour qu’on ne sorte pas vraiment de l’UE. »
John Major appelle à un deuxième référendum
La réaction virulente des conservateurs et du DUP est cependant mise à mal par l’opposition travailliste, qui a proposé lundi de rester dans l’union douanière européenne. « La guerre rhétorique entre l’UE et le Royaume-Uni doit cesser, estime Keir Starmer, le porte-parole des travaillistes sur le Brexit. L’échec de Theresa May à offrir une solution viable sur l’Irlande du Nord revient la hanter. »
Pire encore pour Mme May, l’ancien premier ministre John Major a fait une sortie très remarquée. Lui qui prend peu la parole estime que rester dans l’union douanière est la seule solution sur la question irlandaise. Dans un long discours, il a aussi appelé à un deuxième référendum, cette fois-ci sur les modalités de la sortie de l’UE.
Cette confusion politique survient alors que Mme May doit prononcer, vendredi 2 mars, un grand discours sur le Brexit. Elle doit en principe faire des propositions plus détaillées sur la façon dont elle espère régler la sortie de l’UE. Elle sera écoutée très attentivement à Bruxelles, comme à Londres.